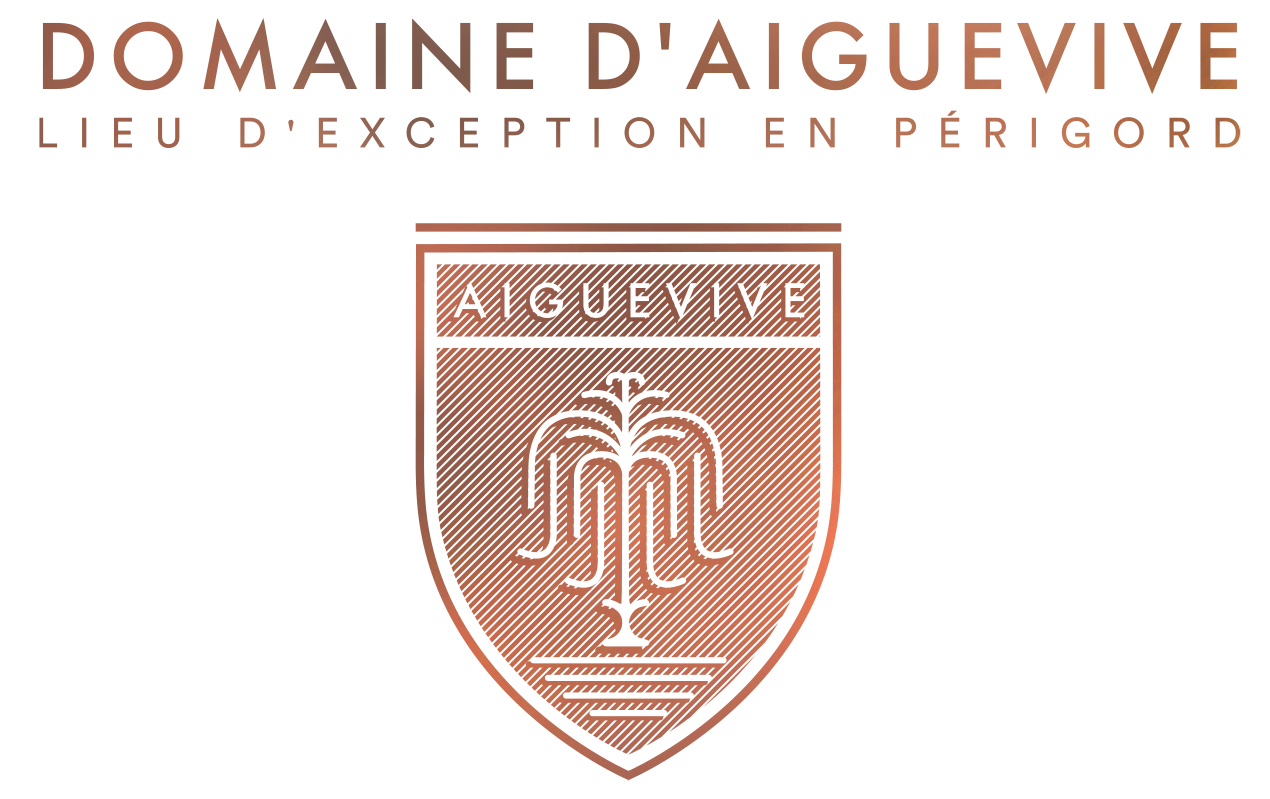Aiguevive (ou viviers) à Cénac-et-Saint-Julien
Aiguevive fut tout d’abord dénommé Domaine de Viviers en 1660, alors propriété des Labories de Campagne, les Cordis, sieur de Vivier, et à l’initiative d’Antoine de Cordis aumônier du roi de France qui en fit l’acquisition en 1612 à Jean de La Borie de Campagne. Il fut cédé plus tard à Joseph de Labroüe, sieur de Montgrieux.
L’histoire du domaine est tout d’abord liée à l’exploitation des moulins (à blé et à huile de noix) et un acte de vente de l’an 1480 permet de dater cette exploitation alors très prospère en Pays Dommois.
Le Château du Vivier est répertorié sur la Carte de BELLEYME (1762-1783), « Cartes topographiques de la Guyenne » n° 30, gravure sur cuivre) et sa construction est, de nombreuses sources littéraires, datée du milieu de XVIIIe siècle. Au XVIIIe siècle, Vivier est dans la succession de Bertrand Maleville, sieur de la Treille, et en 1770, il passe par mariage à Joseph-Geoffroy de Bessou, sieur de Lacoste et Marobert. À la fin du XVIIIe siècle, il appartient à Jean Chassaing. L’actuel manoir fut agrandi sous l’Empire après son acquisition par Etienne de Mouleydier comme l’atteste une description très précise de sa composition ainsi que celle des dépendances du domaine. En 1809, c’est « une maison de maître avec jardin et deux moulins ».
« L’élégant manoir que l’on peut admirer de nos jours fut transformé à partir de 1813, date à laquelle Jean-Baptiste Mercié, notaire dommois, en fit l’acquisition. Selon la tradition, la demeure a été agrandie avec des pierres provenant du Château du Roy, une forteresse érigée sur le plateau de Domme au Moyen Age, et plus particulièrement avec les pierres du donjon, autrement appelé La Tour Brune, que Jean-Baptiste Mercié avait racheté à Jacques Molènes. La maison fut inaugurée lors d’un banquet privé le 8 octobre 1822 en présence de nombreuses personnalités. »
« En 1844, Jean-Baptiste Mercié, résidant à Domme, y transfère son domicile. Sa fille revend le Viviers en 1872 à un militaire, Henri de Maynard, qui avait des attaches familiales au château de Monbette, situé tout près de là. Il va à son tour, en 1875, embellir la maison.
En 1904, le docteur Luc Lalande est le nouveau propriétaire de Viviers. En septembre 1925, sa veuve et ses enfants la vendirent au peintre Lucien de Maleville. Une vaste restauration de la maison, des dépendances et des moulins est entreprise dès 1926. Il s’y installe en 1931 avec son épouse. Ils y demeureront en alternance avec la région parisienne, jusqu’à la mort du peintre en mai 1964. »
Textes enrichis des travaux de recherches historiques et archivistes réalisés en 2023 par Anne BÉCHEAU, Histoire du domaine de Vivier (Ayguevives) à Cénac et Saint-Julien, à la demande de Jean-Xavier Neuville.
Le Manoir d’Aiguevive est surtout connu grâce à Lucien de Maleville dont un des ancêtres fut Jacques, marquis de Maleville et Pair de France, qui fut corédacteur du Code Civil de la République. Son descendant, le Comte Lucien de Maleville, peintre post-impressioniste reconnu et également recenseur des Monuments Historiques, fit l’acquisition du domaine au début du vingtième siècle et y installa son atelier, lieu de création de la plupart de son œuvre. Lucien de Maleville décida de débaptiser sa propriété de Vivier pour éviter des erreurs incessantes de facteurs qui confondaient Monsieur Maleville de Vivier, possédant une propriété située à quelques centaines de mètres, et Monsieur Lucien de Maleville, résidant au Manoir de Vivier. C’est ainsi que le nom Manoir d’Aiguevive fut adopté.
En novembre 1997, Guy de Maleville, fils de Lucien de Maleville, vendit la propriété d’Aiguevive à Jacques et Fabienne Louge qui entreprirent de titanesques travaux paysagers et de modernisation du manoir et de ses dépendances. Ils initièrent le domaine dans sa forme actuelle, en constituant un écrin végétal d’environ 5 hectares plantés de 400 noyers, issus de 14 variétés et destinés à la nuciculture. Ils renouèrent avec la tradition dans les années 2000 en installant un authentique et ancestral moulin pour la production d’huile de noix.
Depuis avril 2021, Aiguevive appartient à un couple franco-suisse. Si le Manoir conserve sa vocation de maison de famille, il n’en demeure pas moins que les actuels propriétaires engagèrent d’importants travaux afin d’ouvrir le domaine au public. L’atelier de Lucien de Maleville fut, à la mort du peintre, laissé à l’abandon puis vidé de son contenu. Il ne reste aujourd’hui plus aucune trace de l’ancien atelier de l’artiste à Aiguevive. La dépendance dans laquelle il était établi bénéficia d’une rénovation majeure et, est aujourd’hui, une très cossue maison d’hôtes : La Maison d’Armelle.
Les dépendances du Moulin et de l’Huilerie, quant à elles, se muèrent en lieux réceptifs. Sous l’égide de l’Agence Neuville, qui consacre l’art de vivre, sont conçues depuis 2023 les activités culturelles et événementielles du Domaine.

Une histoire pluri-millénaire
L’histoire du Périgord remonte à la Préhistoire ; même si nul ne sait pourquoi, le Périgord, il y a 400 000 ans, fut la terre d’accueil des hommes préhistoriques. On relève que plus de 80% de découvertes sur cette période dans le monde l’ont été en bordure de ses fleuves Dordogne et Vézère : grottes ornées, peintures, sculptures, gravures, habitats troglodytes. Le joyau étant la grotte peinte de Lascaux (-33000 ans avant notre ère) que Picasso dénomma la « Chapelle Sixtine de la Préhistoire ». Puis viendra le Moyen Âge avec ses châteaux, ses forteresses, ses bastides construites notamment lors de la guerre de 100 ans entre le royaume de France et celui d’Angleterre, la frontière étant caractérisée par la Dordogne. La vallée de la Dordogne et ses villages illustrent aujourd’hui la prospérité marchande du Périgord grâce à son passé d’activité fluviale, moyen de transport de ses productions dont le bois, les noix, les vins et les produits de sa métallurgie.
Réserve mondiale de la biosphère
Du centre de la France à l’estuaire de la Gironde, la rivière Dordogne parcourt près de 500 kilomètres. Ancien axe commercial, elle a longtemps été frontière naturelle entre territoires rivaux comme en témoignent ses nombreux châteaux forts. Avec ses paysages préservés, elle a été classée le 11 juillet 2012 « Réserve Mondiale de la Biosphère » par l’UNESCO. C’est la seule rivière de France à posséder ce prestigieux label. À cette occasion le bassin de la Dordogne a intégré le réseau mondial des Réserves de biosphère qui en 2020 rassemble 701 sites d’exception à travers les cinq continents.
PATRIMOINE MONDIAL DE L’HUMANITÉ
La reconnaissance suprême de la région fut la protection et la labélisation de la vallée de la Vézère à l’inscription de la liste du « Patrimoine Mondial de l’Humanité » par l’UNESCO. Sous l’appellation sites préhistoriques et grottes ornées de la vallée de la Vézère, 14 sites de la vallée de la Vézère ont été classés au patrimoine mondial de l’UNESCO en octobre 1979. Ce véritable sanctuaire de l’art préhistorique est l’un des sites archéologiques les plus importants d’Europe. Après les premières grandes découvertes archéologiques, la majorité de ce patrimoine est toujours accessible au public : musées, gisements, grottes ornées originales ou reproduites, permettant aux visiteurs de partir à la découverte de l’Histoire de l’Homme moderne.
LA VILLE DE SARLAT
Le plus célèbre de ces bourgs est sans conteste Sarlat, capitale du Périgord Noir, ville de 10 000 habitants, et joyau de l’architecture médiévale qui accueille chaque année 1,5 millions de touristes venus du monde entier. Lieu de tournage de films, réceptacle de festivals – de théâtre, Festival du film – Sarlat présente une concentration de monuments historiques classés au mètre carré qui la place en première position française par rapport à sa superficie.
Aux environs, 10 villages en bordure de la rivière Dordogne sont classés parmi les Plus Beaux Villages de France, la vallée étant elle-même labellisée Site Majeur d’Aquitaine. Sa culture : outre l’architecture et la conservation de ses nombreux monuments historiques (1500 classés), ses jardins remarquables, ceux d’Eyrignac et de Marqueyssac.
LA GASTRONOMIE DU PÉRIGORD
Le Périgord s’enorgueillit d’une réputation gastronomique internationale, grâce à ses nombreuses productions de produits de qualité (IGP/AOC/AOP Indication Géographique Protégée, Appellation d’Origine Contrôlée et Protégée dont le foie gras du Périgord, la truffe du Périgord, la noix du Périgord, les fraises du Périgord, les vins de Bergerac, les châtaignes, les cèpes). De nombreuses animations thématiques autour de sa gastronomie (salons et expositions) sont organisées localement et attirent de nombreux visiteurs.
À l’international, la gastronomie périgourdine et ses produits labellisés participent activement à la richesse de la cuisine française. L’addition de son histoire, de ses paysages et de sa culture gastronomique concourt à qualifier le Périgord pour sa qualité de vie, son harmonie et son art de vivre, salués par de très nombreux artistes et entretenus par ses nombreux touristes qui, chaque année, sillonnent ses routes.